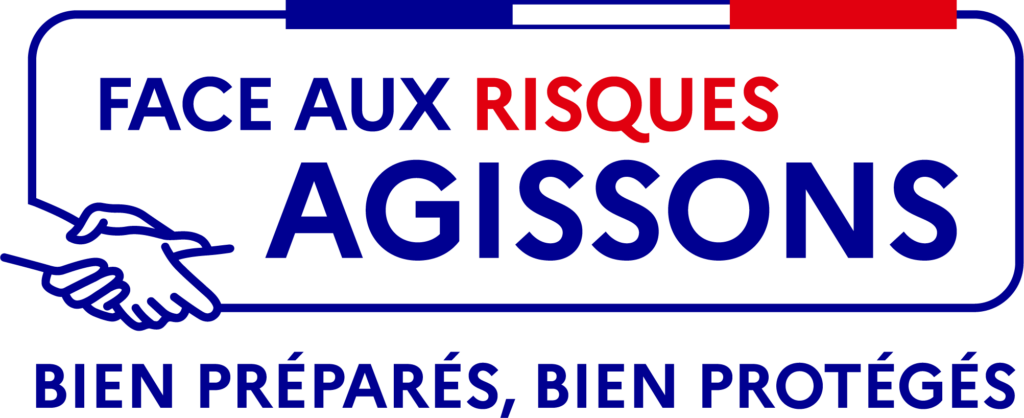« Alerter précocement pour prévenir et corriger »
- Colloque
- du 27 au 28 février 2025
- 13h-16h
Amphi RS 031
I. Alerter pour prévenir l’escalade de la violence sur la scène internationale
II. Alerter pour prévenir toute menace à la sécurité intérieure
III. Alerter pour protéger les populations face aux vulnérabilités climatiques et sanitaires
Présentation du thème
Si la notion d’alerte est largement étudiée par la doctrine, celle « d’alertes précoces » apparaît comme un impensé. Le syntagme est parfois employé dans le langage courant, notamment dans le domaine environnemental, pour évoquer la nécessité d’anticiper une catastrophe naturelle ou un dérèglement climatique d’importance, ou dans le domaine diplomatique sur la question de la prévention des conflits ou de la résolution des crises. Il l’est même de plus en plus fréquemment dans les instances internationales onusiennes, africaines, américaines ainsi qu’européennes.
Prévenir la menace, prévenir le risque, prévenir la crise, prévenir le conflit sont autant d’objectifs ambitieux que se donnent les acteurs publics et privés pour éviter la détérioration d’une situation qui pourrait entraîner la perte de vies humaines. Ces ambitions traversent l’ensemble des champs de la société : le risque est sécuritaire, étatique, sanitaire, environnemental, économique…. Quelle que soit la nature du risque, la prévention implique la mise en place d’instruments adaptés permettant de détecter l’évolution d’une situation et de cibler les moments où la situation pourrait devenir incontrôlable, de telle sorte que la société puisse réagir avant que la situation ne se détériore.
Les instruments d’alertes précoces / alertes rapides visent précisément à mieux anticiper les crises et informer le décideur pour qu’il puisse prendre la mesure de ces risques et adopter les mesures nécessaires pour s’adapter et ainsi éviter la crise, ou mieux anticiper pour l’éviter. L’intérêt de ces instruments est indéniable, même s’il ne faut pas leur accorder une dimension qu’ils ne possèdent pas, celle de prévenir toute perturbation.
Dès lors, l’absence d’études scientifiques approfondies sur la notion d’alertes précoces laisse un vide qu’il importe de pouvoir combler. Ainsi, le colloque organisé à la Faculté libre de droit de Lille ambitionne de délimiter plus précisément les contours de la notion, contribuer à la compréhension approfondie de la notion et fournir les bases d’une recherche plus approfondie, en croisant les regards d’experts, de praticiens et d’universitaires.
Programme
Inscription